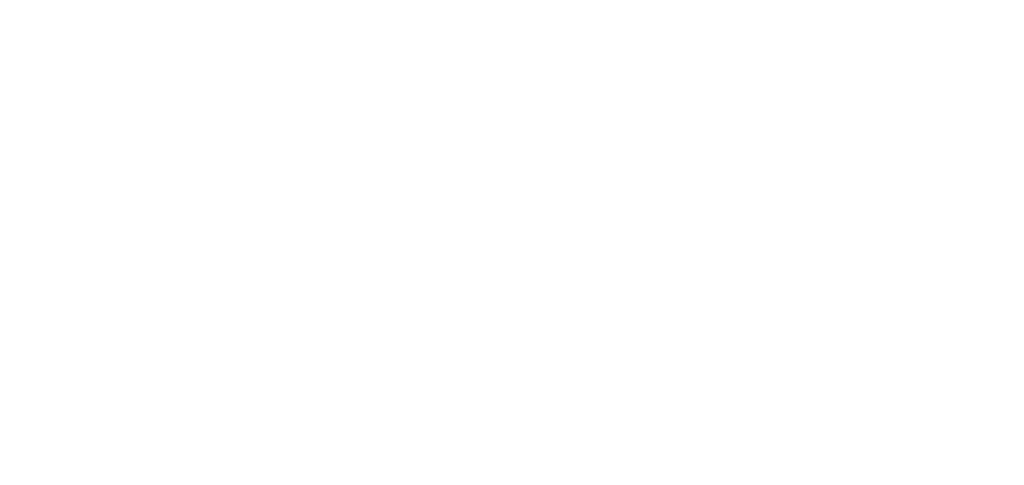Les huit représentations de La Bohème de Giacomo Puccini vont se jouer quasiment à guichet fermé. De nombreuses raisons à cela, nous allons y revenir. Mais les tonnerres d’applaudissements au rideau final et les multiples et enthousiastes rappels sont la preuve d’un public qui a retrouvé les chemins capitolins et l’envie d’un spectacle vivant qu’il sait de grande qualité.
Les metteurs en scène l’expliquent dans une courte note d’intention incluse dans le programme. De toute façon, La Bohème a quelque chose d’intemporel, c’est un opéra que l’on pourrait transposer à de nombreuses époques différentes. Comme ils ont raison. La preuve, in loco il y a douze ans, la vision « sdf » de Dominique Pitoiset, ou encore celle de Claus Guth à l’Opéra Bastille en décembre 2017 situant avec une intelligence virtuose cet opéra…dans l’espace. C’est de Glasgow où elle fut créée en 2017 que nous arrive la production de la présente reprise de La Bohème à l’Opéra national du Capitole. Barbe et Doucet en sont les maîtres d’œuvre. Ils nous proposent, dans un décor parisien 1920 de nous faire vivre les amours malheureuses du poète et de la petite cousette. Mais le prologue est à lui seul un autre voyage, celui dans le Paris d’aujourd’hui, avec selfies obligés. Sur cette petite place, un brocanteur et une jeune femme, Mimi, dont le foulard sur la tête et le teint blafard ne laissent aucun doute sur la maladie qui la ronge. Elle observe tout ce petit monde, y compris une chanteuse de beuglant qui, accompagnée d’un accordéoniste, se lance dans les standards pour touristes. C’est Musette dans l’éternité du mythe. Un disque est posé sur une platine. Les premiers accords de l’opéra de Puccini se font entendre de loin puis c’est l’orchestre qui enchaîne. Opération délicate il faut en convenir… La jeune femme disparait et la pièce peut commencer, comme si elle la rêvait. Retour donc vers le passé, cent ans en arrière. Mais pourquoi pas. De toute manière, les vies de bohème sont éternelles. Pour les craintifs de versions percutantes, point de séisme ici mais une cohérence, une direction des chanteurs, une subtilité de jeu autour de maints détails qui finiront par nous laisser en larmes au rideau final.

Lorenzo, Liparit, Mikhaïl et les autres pour une Bohème gagnante
Il a 31 ans, mince comme un fil mais d’une précision et d’une énergie redoutables. Il s’agit du maestro Lorenzo Passerini. Ce qu’il nous fait entendre ce soir-là est quasiment une autre Bohème, celle qui annonce le génie musical des dernières œuvres de ce compositeur. Timbres, mélodies, dynamiques et même les silences assourdissants du drame en train de se jouer. Plutôt que de confondre les pupitres dans une gigantesque vague sonore, Lorenzo Passerini détaille chacun d’eux, leur laissant la possibilité de magnifier les lignes musicales. Il faut voir aussi combien il s’attache aux chanteurs. Il le sait, beaucoup sont non seulement jeunes comme lui mais en plus débutants dans ces rôles. Il les couve littéralement du regard et de ses bras qui battent avec élégance et précision une partition qui est en fait une véritable course à l’abîme.

Christophe Ghristi, s’alignant sur la grande tradition capitoline instaurée par Nicolas Joel, nous offre deux distributions. Celle de ce soir ne passe pas inaperçue. Loin s’en faut. Et tout d’abord le somptueux Marcello du baryton russe Mikhaïl Timoshenko. Grand gaillard d’une redoutable efficacité scénique, il double cet impact dramatique d’une voix de baryton lyrique dont on sent à l’évidence les promesses d’un avenir verdien. Emission d’une rondeur confortable, projection lui permettant de passer sur des ensembles dans lesquels il n’est pas rare de ne pas entendre l’interprète, timbre d’une grande densité et d’un métal qu’il sait adoucir sur des demi-teintes soyeuses. Le souffle et son corollaire, le phrasé, nous rendent impatients de le revoir dans un autre rôle plus exposé vocalement dans lequel il devrait démontrer un cantabile superbe. Le ténor arménien Liparit Avetisyan (Rodolfo) nous donne à entendre une voix qui rappelle furieusement celle du jeune Pavarotti. Ce n’est pas forcément une injure. La voix est longue, celle d’un lyrique parfaitement homogène, ici encore l’émission est franche et les registres soudés. L’aigu est flamboyant, lumineux, sans faille. Le phrasé est large et le musicien présent dans toutes les situations intimes qu’il sait parer de demi-teintes somptueuses. Pour en finir avec « les garçons », saluons l’autorité scénique et vocale de Julien Véronèse, Colline qui nous détailla une défroque à faire pleurer les pierres. Edwin Fardini (Schaunard) creuse au Capitole le sillon d’un artiste aux immenses qualités qui se devra bientôt d’affronter d’autres chalenges. Pour l’heure son « musicien » a une classe incroyable. Saluons également Matteo Peirone pour son double rôle et en particulier celui de Benoît. On devine chez lui une interprétation peaufinée de très nombreuses fois sur toutes les scènes du monde. Un régal !

Vannina Santoni incarne une Mimi chez laquelle l’émotion naît de chaque note. Elle sait mettre dans son phrasé toute la douleur de son avenir en même temps que le bonheur éphémère de sa rencontre avec Rodolfo. Même si le chef veille avec bienveillance à l’équilibre fosse-plateau, il n’en faut pas moins reconnaitre chez cette cantatrice de réelles qualités dans le haut du registre et une musicalité souveraine. La Musette de Marie Perbost est celle que l’on attendait. Pétillante, racoleuse, coquine, amoureuse, et formidablement émouvante. A elle seule elle phagocyte tout le second acte avec une maestria redoutable. Saluons enfin le Chœur et la Maîtrise du Capitole sous la direction de Gabriel Bourgoin, ici dans une partition extrêmement complexe, ainsi que Michel Glasko, l’accordéoniste auquel peut être Puccini n’avait pas pensé mais qu’il aurait certainement apprécié. Rappelons pour la petite histoire que le compositeur aurait souhaité pour Musette une chanteuse de café-concert…
Robert Pénavayre
Renseignements et réservations : www.theatreducapitole.fr
Représentations jusqu’au 6 décembre en double distribution.