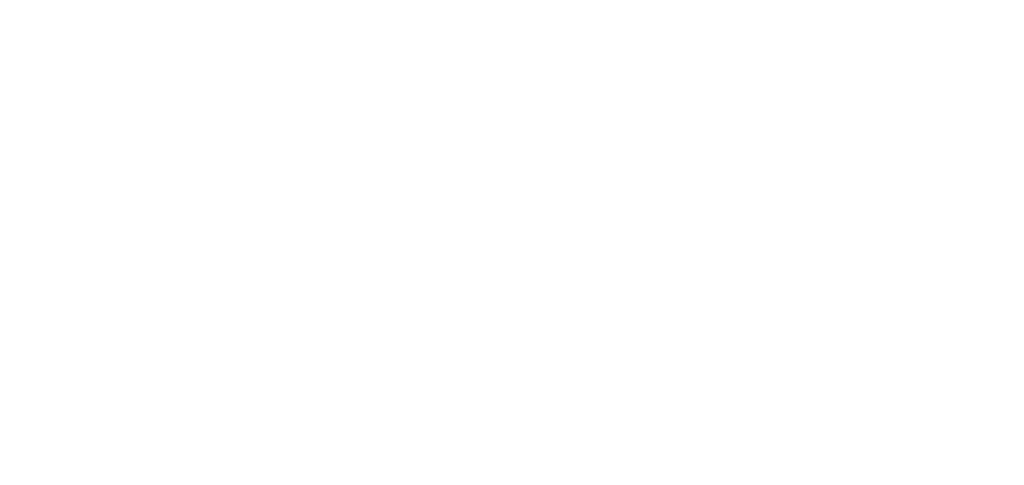En confiant à Frank Castorf la mise en scène de L’Anneau du Nibelung pour la célébration du bicentenaire de la naissance de Richard Wagner, la direction du festival de Bayreuth se doutait bien qu’un parfum de scandale ne manquerait pas de se répandre sur la « colline sacrée ». D’autre part, charger le jeune Kirill Petrenko, encore peu connu des milieux lyriques, de sa direction musicale constituait un deuxième défi. Le scandale déclenché par la production de Frank Castorf a bien eu lieu parmi le public plutôt traditionnaliste de ce festival, mais l’essentiel du succès est allé à Kirill Petrenko pour l’admirable travail qu’il a accompli à la tête de cet orchestre particulièrement en forme au cours de cet été 2013.
Ainsi qu’il le proclame dans le programme de salle, Frank Castorf voit au travers de ce cycle légendaire du Ring, une possibilité d’y associer l’histoire de la découverte et de l’exploitation du pétrole au cours des époques récentes… Pourquoi pas ? On ne pouvait s’attendre, de la part de ce bouillant animateur de la Volksbühne de Berlin, adepte de Bertolt Brecht, à une fidèle et simple illustration, au pied de la lettre, du mythe légendaire mis en vers et en musique par Wagner. Le spectateur n’a donc plus qu’à se débarrasser de l’idée qu’il se fait d’une saga nordique avec dieux, géants, démons, héros et symboles et tenter de se laisser convaincre par une vision que l’on peut qualifier, sans la déformer, d’iconoclaste et de « distanciée », pour utiliser un terme cher au théâtre brechtien. Imagination et provocation caractérisent ainsi le travail, indéniablement fouillé, de l’homme de théâtre qu’est Frank Castorf.
Tout commence avec ce Rheingold foisonnant, prologue essentiel, socle et point de départ de la tragédie qui va s’étirer sur trois journées intenses.
Das Rheingold sur la route 66
Avec une certaine virtuosité théâtrale, le metteur en scène imagine ici une action qui obéit à la très classique unité de lieu. Point de fond du Rhin légendaire habité par ses naïades mutines, point de Walhalla, château nouvellement construit pour les dieux par une paire de géants effrayants, point de Nibelheim, séjour souterrain des Nibelungen. Toute l’action se déroule au Texas, l’état américain pétrolier par excellence, dans un motel miteux (avec wi-fi !) situé sur la légendaire route 66. Les trois « filles du Rhin » sont ici trois prostituées qui étendent leur lessive au bord d’une petite piscine censée symboliser l’élément liquide évoqué par la musique. Les « dieux », représentés comme un petit groupe plus ou moins maffieux, occupent la chambre à l’étage et les Nibelungen se déplacent dans une remorque métallique (mais oui, le Nibelheim !) contenant le trésor qu’Alberich vole dans la piscine du motel…
L’action qui se déroule ici ne laisse pas un instant de répit au spectateur et il serait injuste de rejeter l’idée a priori pour son impertinence et sa négation du sacré que l’histoire a laissé gravé dans nos mémoires. La confrontation des personnages fonctionne, un vrai talent d’animation des jeux d’acteurs se manifeste d’un bout à l’autre de la représentation. Néanmoins, quelques incohérences dramaturgiques laissent le spectateur dans l’étonnement, notamment dans l’épisode du Nibelheim. Et puis, l’idée, a priori excellente, de réaliser des zooms sur les personnages grâce à l’utilisation de caméras vidéo en temps réel, multiplie parfois les centres d’intérêt au-delà de ce que peut absorber l’œil. Ainsi deux actions simultanées peuvent parfois se superposer et se neutraliser. On peut aussi regretter le manque d’envergure de certains événements évoqués avec vigueur par la musique. Ainsi, le fameux coup de tonnerre du final, censé déclencher l’arc en ciel qui conduit au Walhalla, ne provoque ici que… le rallumage des néons du motel ! Et puis, une fois de plus, ce que l’on voit ne correspond pas toujours (pas souvent ?) à ce que suggère la musique qui reste tout de même l’essentiel.
Le “Golden Motel”, décor unique de ce Rheingold largement transposé.
De gauche à droite : Claudia Mahnke (Fricka), Wolfganf Koch (Wotan), Norbert Ernst (Loge), Sorin Colibran (Fafner), Günther Groissböck (Fasolt), Oleksandr Pushniak (Donner), Lothar Odinius, (Froh), Elisabet Strid (Freia)
– Photo Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath –
La musique justement. Là on peut dire que la réussite est totale. Chaque rôle est parfaitement tenu tant sur le plan vocal que celui du théâtre. Le Wotan veule et avide de Wolfgang Koch projette un timbre de baryton d’une belle rondeur, le Loge virevoltant de Norbert Ernst, le Froh idéaliste de Lothar Odinius, notamment, forment une tribu diverse et cohérente. Toujours parmi les voix masculines, il faut distinguer la puissance sonore autant que dramatique de Martin Winkler, formidable Alberich, la duplicité bien vocale du Mime de Burkhard Ulrich et l’impressionnant duo de géants, Fafner, solide Sorin Coliban, et surtout Fasolt, chanté avec chaleur et tendresse, d’une voix superbe, par Günther Groissböck. Les dames ne sont pas en reste, à commencer par le splendide trio des « filles du Rhin », Mirella Hagen, Julia Rutigliano et Okka von der Damerau. Très belles prestations de Claudia Mahnke (Fricka généreuse et sensible), Elisabet Strid (Freia lyrique et fragile) et enfin Nadine Weissmann, au timbre chaleureux d’alto, qui incarne une Erda de braise, apparaissant, drapée dans sa fourrure immaculée, comme une actrice de film des années trente.
Enfin saluons la direction musicale d’une rare finesse, d’un sens du drame, d’une intelligence des nuances, de Kirill Petrenko. La dynamique optimale qu’il obtient de ce bel orchestre soutient le chant sans jamais le submerger. Une vraie réussite !
Walküre en résidence à Bakou
Poursuivant sa détermination de lier ce Ring à l’histoire du pétrole, Frank Castorf situe cette première journée dans les années 1920 à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan alors sous administration soviétique. Le pétrole, qui y fut découvert très tôt (dès la fin du seizième siècle), est alors un élément important de progrès. Cela dit, cette histoire n’interfère avec l’ouvrage lyrique qu’au niveau du décor, encore ici unique pour les trois actes, ce qui rend d’ailleurs la dramaturgie passablement confuse. Il s’agit apparemment d’un puits de pétrole autour duquel s’agglutinent quelques bâtiments de bois qui accueillent successivement les trois actes. L’usage intensif du plateau tournant facilite le passage fictif d’un lieu à l’autre. Mais la pratique fréquente des projections vidéo sans relation avec l’action scénique concomitante disperse l’attention.
Le décor unique de Die Walküre, ici au premier acte. De gauche à droite : Anja Kampe (Sieglinde), Franz-Josef Selig (Hunding), Johan Botha (Siegmund)
– Photo Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath –
Comme on le voit, la chronologie n’est en rien respectée, puisque le Rheingold, point de départ de cette Tétralogie, était ici censé se dérouler de nos jours. Il est vrai que le metteur en scène a délibérément abordé chaque opéra de manière indépendante les uns des autres, sans rechercher une quelconque cohérence entre les épisodes. C’est là que le bât blesse. De nombreux détails de la mise en scène restent ainsi mystérieux aux yeux du spectateur. Le premier acte souffre d’une baisse de tension dommageable pour le volet le plus « humain » de toute la saga. Ceci malgré, là encore, la qualité irréprochable des chanteurs-acteurs qui sont appelés à se comporter parfois de manière étrange, mais dans un schéma scénique ici assez traditionnel.
Le ténor sud-africain Johan Botha, s’il a un peu de mal à incarner physiquement le personnage de Siegmund, en soutient l’investissement vocal de manière impressionnante. Le timbre sombre du chanteur n’a aucune difficulté à darder des aigus rayonnants : ses deux « Wälse » se déploient avec un héroïsme rare. Ce qui n’empêche nullement les élans de tendresse de son chant. Sa Sieglinde allie beauté physique et intensité vocale. La soprano Anja Kampe, voix parfaite pour ce rôle, émeut par son jeu autant que par son chant habité. La basse allemande Franz-Josef Selig ne fait qu’une bouchée du rôle de Hunding auquel son timbre noir confère un impact effrayant.
Les mêmes problèmes de mise en scène affectent le déroulement du deuxième acte que les excellents interprètes ne parviennent pas toujours à animer. On découvre néanmoins la Brünnhilde juvénile de la britannique Catherine Foster dont le chant ne s’épanouira complètement qu’au troisième acte. Wotan (ici lecteur assidu de la Pravda !) retrouve son fascinant interprète du Rheingold, Wolgang Koch. Curieusement il apparaît là nanti d’une immense barbe qu’il perdra d’ailleurs au troisième acte ! Les mêmes qualités vocales le conduiront jusqu’à des « Adieux » terriblement humains. La Fricka de Claudia Mahnke confirme l’autorité vocale qu’elle déployait dans le Rheingold.
Comme souvent à Bayreuth le bataillon des Valkyries éblouit par son éclat et son ardeur. La chevauchée, qui débute par un petit thé pris en commun autour d’un samovar pendant que quelques manifestants se font tuer ( !), ouvre néanmoins l’acte final sur une irrésistible pièce de virtuosité vocale et instrumentale. Et là encore Kirill Petrenko conduit son orchestre avec la transparence, l’éclat, l’équilibre entre pupitres, entre la fosse et la scène, dignes des plus grands. Le lyrisme de sa direction donne à la confrontation finale Wotan-Brünnhilde une intensité bouleversante que les deux chanteurs portent à incandescence. On retiendra longtemps la grande beauté de la péroraison orchestrale qui rapproche enfin le père et la fille. Un grand moment d’émotion. Indéniablement, ce troisième acte retrouve l’énergie interne qui manquait aux deux précédents. Mais l’aventure continue…
Siegfried et le crocodile…
Non, il ne s’agit pas ici d’un nouvel opéra de Wagner récemment découvert, bien que la production puisse le laisser croire. Cette deuxième journée du Ring, sorte de scherzo dans le déroulement dramatique de la saga, précède la catastrophe finale du Crépuscule des dieux. A l’évidence, Frank Carstorf s’est ici particulièrement lâché, comme s’il souhaitait pousser la désacralisation à son point extrême. Répétons que sa mise en scène se révèle d’une complexité et d’une élaboration incontestables. Mais là plus qu’ailleurs, la musique contredit ce que le spectacle nous offre à voir. Sans musique, on assisterait volontiers à une telle pièce de théâtre pleine d’une imagination fertile…
Le décor étonnant du premier acte pendant la rencontre entre le Wanderer et Mime.
De gauche à droite : Wolfgang Koch (Wanderer), Burkhard Ulrich (Mime)
– Photo Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath –
Evoquons tout d’abord l’aspect musical de cette représentation du 25 août. L’orchestre, dirigé une fois de plus avec un soin, une finesse, une dynamique, un sens des silences suspendus, en tous points admirables, reste l’acteur principal. Kirill Petrenko poursuit son exploration en convoquant de belles ressources de couleurs de la part de ses musiciens. A cet égard, le prélude de l’ouvrage installe une étonnante atmosphère, étrange et inquiétante. Le raffinement de l’orchestration se manifeste au niveau des interventions solistes. Même si, dans le reste de la représentation, le cor solo n’est pas à l’abri de quelques défaillances.
Du côté de la distribution, regrettons le peu d’attraits vocaux de l’interprète principal, Lance Ryan, qui ne possède plus l’éclat, ni la stabilité de vibrato d’un authentique Siegfried. L’habileté de l’interprète ne compense pas la sécheresse d’un timbre fatigué. Le Wanderer de Wolfgang Koch reste dans la lignée de son Wotan, même si l’endurance exigée pour un tel rôle met à l’épreuve la qualité de ses couleurs vocales. Le formidable Alberich de Martin Winkler prolonge avec éclat sa prestation du Rheingold. Le Mime de Burckhard Ulrich, parfaitement en situation, surjoue un peu son rôle de veule en caricaturant à l’extrême le timbre de sa voix et usant un peu trop du Sprechgesang, alors que le rôle de Fafner est toujours excellemment tenu par Sorin Colibran. Mirella Hagen chante et joue un oiseau rutilant de plumes et de dorures avec la légèreté et la virtuosité nécessaires. Erda est une fois de plus incarnée avec intensité par Nadine Weissmann à laquelle Frank Castorf réserve un jeu scénique bien particulier… Enfin, la Brünnhilde de Catherine Foster conjugue héroïsme et sensibilité dans une scène finale éprouvante à la fois vocalement et scéniquement.
Première surprise apportée par la mise en scène, il n’est ici plus question de pétrole. Par ailleurs l’unité de lieu n’est plus recherchée et il n’existe que peu de liens avec ce qui précède. Ainsi, Brünnhilde ne se réveille point à l’endroit où elle s’est endormie.
La rencontre entre Siegfried et l’oiseau de la forêt
au deuxième acte.
De gauche à droite : l’oiseau (Mirella Hagen), Siegfried (Lance Ryan),
Mime (Burckhard Ulrich) – Photo Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath –
Lorsque le rideau se lève c’est la surprise d’un incroyable panorama. Pour la « grotte » de Mime, la remorque du Nibelheim, découverte dans le Rheingold, est stationnée au pied d’une sorte de Mount Rushmore Monument dans lequel les têtes de Marx, Lénine, Staline et Mao remplacent celles des présidents américains. Beau décor, couplé sur l’autre face du plateau tournant à une représentation réaliste de l’Alexanderplatz, de Berlin, avec son bureau de poste et sa station de métro. Tout l’opéra, qui oscille entre les deux sites, baigne dans une atmosphère surréaliste. Au cours du deuxième acte, dit « de la forêt » (qui se déroule ici sur les trottoirs de Berlin), Siegfried abat Fafner, devenu souteneur, d’une bruyante rafale de kalachnikov qui fait sursauter tout le public.
Je ne résiste pas au plaisir d’évoquer les hallucinantes trouvailles du troisième acte, le plus déjanté des trois. La scène entre Wotan et Erda, au cours de laquelle se décide pratiquement le sort du monde, se déroule au bar du bureau de poste devant un canon de rouge et un plat de spaghettis. Madame Erda, déesse de la Terre, harnachée comme une mère maquerelle, essaie de convaincre Monsieur Wotan de suivre ses conseils en employant les moyens les plus… extrêmes. La décence m’empêche d’entrer dans les détails !
Venons-en à l’ardent duo final par lequel Siegfried éveille Brünnhilde à la vie et à l’amour. Commencé au pied du pseudo Mount Rushmore, il s’achève sur l’Alexanderplatz. Comble du surréalisme, un crocodile (mais oui, je n’ai pas rêvé) apparaît sur le plateau. Nourri de morceaux de pain que lui lance Siegfried tout en déclarant sa flamme à Madame Brünnhilde, le pauvre animal est forcé par cette dernière à avaler un parasol. Pendant ce temps, l’écran vidéo, toujours actif, montre les images d’un couple de crocodiles amoureux, dont l’un dévore sous nos yeux l’oiseau tout emplumé ! Fort heureusement Siegfried vient au secours de l’oiseau avec lequel il a d’ailleurs déjà eu quelques rapports intimes. Pour couronner le tout, il fait mine de partir avec lui (ou plutôt elle !). Pour la bonne morale, il revient néanmoins vers sa nouvelle bien-aimée pour la conclusion de l’acte et de l’œuvre. Une bien-aimée qui a eu le temps de revêtir sa robe de mariée dans l’arrière-boutique du bureau de poste…
Il faut absolument féliciter les interprètes qui jouent le jeu avec professionnalisme, ajoutant aux difficultés du chant celles d’un jeu d’acteur particulièrement exigeant bien que sibyllin. Le public ne s’y trompe pas qui acclame les chanteurs tout en conspuant la mise en scène, à défaut de pouvoir s’adresser directement à son concepteur, lequel ne devrait venir saluer qu’à la fin du dernier épisode de la saga.
Noir Crépuscule
A la grande déception des détracteurs, chaud remontés contre la mise en scène de ce Ring, Frank Castorf n’est finalement pas venu saluer à l’issue de ce Götterdämmerung. Cette conclusion d’une production réputée scandaleuse mérite pourtant, malgré ses défauts, ses défaillances et ses impertinences, mieux que le mépris ou l’opprobre. Après les outrances risibles de Siegfried, ce Crépuscule paraît presque sage. En tout cas plus équilibré et il bénéficie de certains atouts incontestables, ne serait-ce que sur le plan musical.
Acte I : Le domaine des Gibichungen. Hagen (Attila Yun) et Gutrune (Allison Oakes)
– Photo Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath –
Redisons ici la qualité orchestrale de toute la série. Grâce à la direction vivante, animée, colorée et pleine de relief de Kirill Petrenko, cette dernière journée ne distille pas un instant d’ennui ni d’indifférence. La poésie que la mise en scène ne favorise pas toujours (mais parfois tout de même), se retrouve dans cet orchestre que Wagner voulait un miroir de la scène. Les grandes pages traditionnelles, comme le Voyage de Siegfried sur le Rhin ou la fameuse Marche funèbre, sont habilement intégrés dans le maelström de l’ensemble. De grands moments doivent leur émotion à cet orchestre riche et virtuose dont le chef sait tirer les couleurs les plus intenses.
La distribution vocale reste certes assez inégale, le point faible revenant au rôle de Siegfried, chanté avec effort par Lance Ryan. La voix usée, au timbre ingrat, plus proche de celle que l’on attend pour Mime, pêche par son vibrato tous horizons. Cependant, il sera beaucoup pardonné à l’interprète pour l’intelligence de ses ultimes interventions. Son évocation de l’oiseau, dont il tente d’imiter la voix en demi-teinte, l’émotion qu’il met dans la péroraison qui suit son meurtre ( à coups de batte de base-ball!) sont à placer à son crédit.
Dans l’estaminet des Gibichungen, le serment du sang entre Siegfried (Lance Ryan) et Gunther (Alejandro Marco-Buhrmester). A droite Hagen (Attila Yun)
– Photo Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath –
Dans le trio des Gibichungen, Hagen, chanté et joué par Attila Yun, se distingue par une noirceur vocale totalement féroce et une présence indéniable. Si Gunther (Alejandro Marco-Buhrmester) reste vocalement un peu terne, comme en retrait, Allison Oakes donne vie au personnage de la capricieuse Gutrune. Le retour d’Alberich fournit une fois encore l’occasion d’entendre l’un de ses meilleurs interprètes actuels, Martin Winkler, et Claudia Mahnke, après Fricka, insuffle une passion désespérée au rôle de Waltraute. Quant aux trois Nornes et aux trois Filles du Rhin, on peut difficilement rêver meilleures incarnations. Enfin, saluons la performance de Catherine Foster qui s’approprie avec panache la partition vocale et théâtrale de Brünnhilde. Sans difficulté dans le registre aigu, si héroïquement sollicité, elle arrive en pleine forme pour son immolation finale qu’elle délivre avec une touchante émotion.
Quant à la présentation scénique, elle sait faire oublier les errements de la journée précédente, notamment grâce à un agencement de décors d’une rude beauté et une retenue dans la provocation. Certes rien de traditionnel. Le palais des Gibichungen devient ici un kebab (Döner kebab plus exactement) et une boutique de fruits et légumes (Obst und Gemüse, pour être précis).
L’étonnant décor de Wall Street à l’acte III. Les filles du Rhin (Mirella Hagen, Julia Rutigliano et Okka von der Damerau) et Brünnhilde (Catherine Foster)
– Photo Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath –
Les filles du Rhin occupent une Mercédès rutilante. Les trois Nornes qui ouvrent le prélude apparaissent comme d’étranges SDF en luxueuses robes de soirée ! Dans cette belle scène initiale, elles se livrent à de mystérieuses pratiques de « macumba ». Et c’est sur l’image de Hagen (qui arbore une belle crête de punk allumé) dérivant sur un canot que se conclut l’œuvre.
L’évocation timide du pétrole se retrouve dans un accumulation de bidons, mais également dans l’enseigne lumineuse d’une firme de produits chimiques célèbre en son temps en Allemagne de l’Est et surtout dans l’image finale qui symbolise le pouvoir de l’argent en offrant une vue impressionnante de l’arrogant immeuble de Wall Street à New York, préalablement emballé comme par Christo. La vision militante de la société qui est celle de Frank Castorf se glisse ainsi significativement en cette fin de saga.
En définitive, la production de ce Ring joue curieusement sur une incohérence assumée, intégrant dans son déroulement quelques allusions ou même quelques citations cinématographiques, empruntées soit à Tarantino soit à Eisenstein (ce landau dévalant l’escalier de Potemkine !). La provocation côtoie l’imagination. Et si la musique et l’émotion n’y trouvent pas toujours leur compte, le théâtre sort indéniablement gagnant…