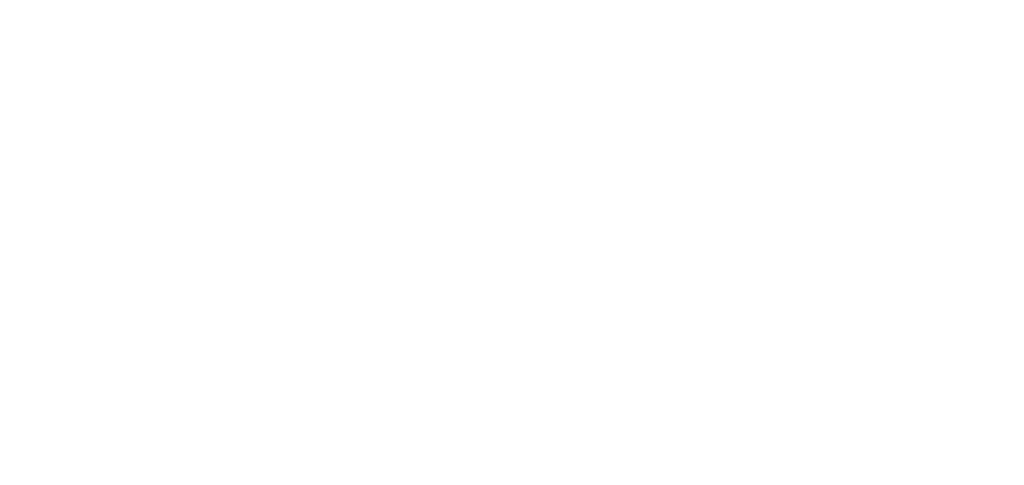Un enthousiasme général et une salle debout ont couronné le récital donné le 15 septembre dernier par le grand Nelson Goerner dans le cloître des Jacobins. Ce fidèle du festival toulousain est devenu l’une des figures essentielles du piano d’aujourd’hui. Sa septième participation, cette année, à Piano aux Jacobins témoigne de son attachement à cette institution qu’il fréquente régulièrement depuis 1991, date de sa première apparition. L’art de ce chaleureux pianiste argentin semble avoir atteint aujourd’hui une sorte de sommet aussi bien technique qu’expressif. Le programme exigeant de son concert toulousain met en évidence la profondeur d’un jeu, d’un investissement personnel du plus haut niveau.
Rappelons que Nelson Goerner, pianiste prodige depuis l’âge de cinq ans, s’est très vite fait remarquer par Martha Argerich, lui ouvrant la porte des scènes réputées. Le Premier Prix à l’unanimité qu’il remporte en 1990 au prestigieux Concours de Genève le propulse sur la scène internationale. Depuis, il parcourt le monde et se forge un répertoire de tout premier plan. Les trois chefs-d’œuvre qui composent le programme de son concert du 15 septembre représentent ce que l’art du clavier peut offrir de plus « consistant ».
Ce triptyque s’ouvre sur le cycle intitulé Aria variata alla maniera italiana (Air varié dans le style italien), BWV 989, de Johann Sebastian Bach. Cette partition, assez rarement donnée en concert et probablement écrite pour clavecin vers 1709, se déroule sous la forme d’un choral suivi de dix variations. Elle présente quelques similitudes avec les fameuses Variations Goldberg. Le toucher clair et généreux de Nelson Goerner laisse s’exprimer toutes les voix de cette géniale polyphonie. L’élégance des phrasés, l’éloquence de cette parole instrumentale parcourent toutes les variations qui explorent les modes extrêmes de l’expression sacrée. De la méditation à la jubilation, le discours, comme toujours chez Bach ainsi joué, touche au sublime.
Le pianiste argentin Nelson Goerner
– Photo Fabian Marelli –
C’est un autre cycle rare au concert qu’aborde ensuite le pianiste. Si l’on entend assez souvent les Kinderszenen (Scènes d’enfants), les Waldszenen (Scènes de la forêt) ou encore les redoutables Kreisleriana, de Robert Schumann, il est moins courant d’y redécouvrir les Davidsbündlertänze, (Danses de la Confrérie de David). Cette suite de 18 pièces pour piano seul composée en 1837, est ainsi nommée en référence à la Confrérie de David imaginée par Schumann par analogie au combat de David contre les Philistins. L’édition initiale de 1838 porte la mention « Pièces caractéristiques composées par Florestan et Eusébius ». Ces deux noms de personnages imaginaires représentent les deux faces de l’individualité de Schumann : d’une part Florestan, « l’assaillant bruyant et pétulant, entièrement honnête, mais souvent adonné à des caprices les plus étranges », d’autre part Eusebius, « l’adolescent tendre qui toujours reste modestement dans l’ombre ». Ce puzzle génial est admirablement abordé par Nelson Goerner. Le pianiste parvient à soigner les détails de chacune des 18 pièces, tout en les intégrant dans une vision globale qui résonne alors comme un vaste portrait. Fougue exubérante et magie poétique alternent tout au long de cette succession à laquelle l’interprète restitue néanmoins son unité organique. Un constant frémissement de vie anime tout le cycle qui s’achève sur une douce berceuse et s’éteint sur un do grave, comme en prélude au sommeil. Admirable !
Toute la seconde partie de la soirée est consacré à la plus complexe, la plus imaginative des 32 sonates de Beethoven, l’opus 106, n° 29, intitulée Hammerklavier (Piano à marteaux, autrement dit, pianoforte). Cet Himalaya du clavier, destiné aux instruments les plus modernes de l’époque dont il exploite toutes les nouvelles possibilités techniques, est évidemment bien plus qu’une simple mise en valeur instrumentale. Elle est sa plus vaste partition pour piano solo par sa longueur et l’exceptionnelle ampleur de son souffle. Ainsi que l’assume impérialement Nelson Goerner, la Hammerklavier est en fait un concentré de démesure. Sous ses doigts, les premières mesures de l’Allegro initial résonnent avec violence comme un appel exalté. Dans le déploiement des contrastes extrêmes de ce mouvement, l’interprète va au bout de l’exigence. A la suite de ce déploiement explosif et cyclothymique, le Scherzo apaise brièvement l’esprit. Teinté d’un humour parfois grinçant, il ne se résume pas au jeu habituel de ce type de pièce. Il laisse la parole au centre de gravité (dans les deux sens du terme) de la sonate, l’Adagio sostenuto. S’ouvre alors tout un univers de douleur, de souffrance. L’interprète se fait medium, s’efface devant l’indicible. Par le jeu des timbres et des couleurs, il brosse un tableau d’une bouleversante noirceur. La transition vers le final adopte le caractère d’un éveil progressif. Le dernier mouvement, d’une complexité extrême, s’écoute comme une alternance entre espoir et désespoir. Le retour à la fugue, structure emblématique de la période baroque, organise ici l’exaltation de la pensée. Les interruptions que subit ce cheminement désespéré vers la lumière sonnent ici comme des entraves tragiques. Tout un univers se déploie jusqu’à cette conclusion d’une ambigüité extrême : est-ce l’espoir ou le malheur ? L’interprète s’investit dans ce voyage au cœur de l’humain avec profondeur et intensité.
Il fait un certain temps pour se remettre ! Néanmoins, l’accueil crescendo du public obtient du pianiste deux pièces supplémentaires. A la tendresse poétique du Nocturne op. 55 n° 1, de Frédéric Chopin succède une ahurissante Etude pour la main gauche du compositeur russe Felix Blumenfeld. Nelson Goerner donne là l’impression de survoler le clavier au point d’y joindre une deuxième, voire une troisième main invisible ! Stupéfiant de virtuosité de la part d’un artiste si empreint de profondeur expressive…