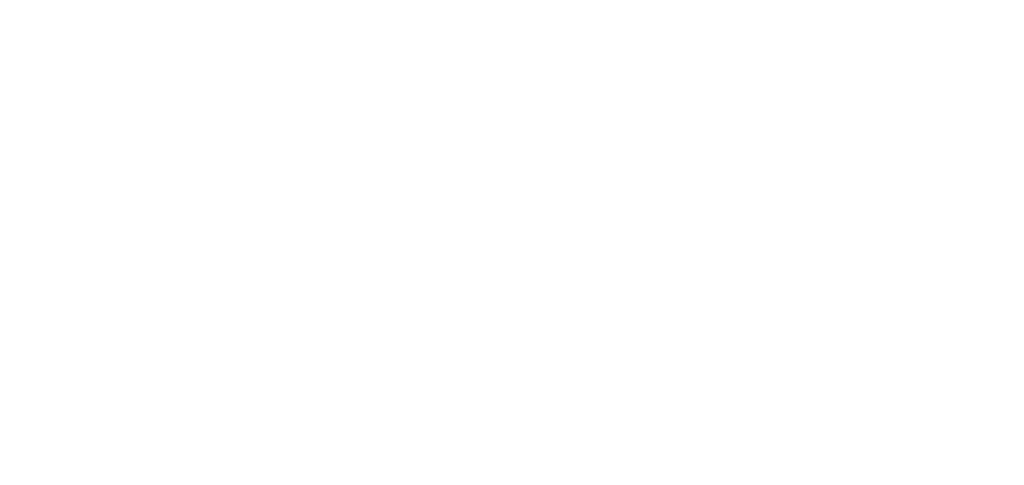Depuis vingt-trois ans, Mont de Marsan troque au mois de juillet, le bleu et blanc landais contre le vert et blanc andalou. Partout dans les rues résonnent des accords de guitare, des claquements de castagnettes, des « palmas » et ce « cante jondo » venu de la nuit des temps. Les petites filles arborent robes à volants et fleurs dans les cheveux et les tapas parfument toutes les tables. Mais le plus important ce sont bien sûr les artistes invités. Et cette année le plateau était royal : María Pagés, Milagros Menjíbar et Luisa Palicio, Farruco, Israël Galván et Rocío Molina, pour les danseurs, David Peña Dorantes au piano, la chanteuse Esperanza Fernández, et bien d’autres encore.
María Pagés
– Photo Sébastien Zambon –
María Pagés : « Mirada »
C’est cette grande dame du flamenco qui ouvrait le Festival, avec Mirada, ballet créé pour le vingtième anniversaire de sa Compagnie. Celle qui fut l’une des premières danseuses d’Antonio Gadés, et qui dansa auprès de Manolo Marín, Mario Maya ou Matilde Coral, définit son spectacle comme un regard vers l’avenir car dit-elle : « Je regarde en arrière, mais sans m’arrêter ». Sa chorégraphie fait évoluer sa compagnie, quatre danseuses et quatre danseurs, sur des compás traditionnels avec beaucoup de rigueur (héritage évident de Gadès). Les salves de zapateado sont parfaitement synchrones, les guitares, le violon et le chant ont l’accent juste et soulignent chaque mouvement, chaque envol de jupes. Mais María Pagés domine cet ensemble par une présence, une maturité, un port de bras royal, une maîtrise de la « bata de cola », mais aussi une gouaille et un humour peu habituels dans le flamenco (hormis peut-être dans les bulerías). Au-delà de la musique elle s’appuie aussi sur les poètes andalous, et la lune si chère à Lorca accompagne en fond de scène une grande partie du spectacle. Et pour compléter cette magie il y a les costumes dessinés par la danseuse, dans des tons de terre, de ciel et feuilles avec de très subtils dégradés, un modernisme incontestable (n’y voit-on pas des éléments de tableaux de Miró) et comble de raffinement, les motifs sont peints à la main. Il y a cependant quelques moments étranges, insolites, dans ce ballet. Ainsi, la très romantique Mort du Cygne de Saint-Saëns à la mode flamenca, où les bras sinueux et ondoyants de María Pagés perdent curieusement une partie de leur souplesse, ou bien encore des pas de flamenco sur La valse de Chostakovitch, le Casta Diva de Maria Callas, en passant par Oh when the saints go marching in, interprété par Louis Armstrong. Rien n’étant improvisé dans le jeu de María Pagés, tout cela doit avoir un sens, mais qui est resté pour nous assez hermétique. Le public, conquis, a fait un triomphe à cette danseuse qui reste exceptionnelle.
Milagros Menjíbar
– Photo Sébastien Zambon –
Milagros Menjíbar et Luisa Palicio. « Piel de Bata »
La « bata de cola », cette robe andalouse que termine une longue traîne volantée est certainement l’un des accessoires les plus « vistosos », les plus spectaculaires de la danse flamenca.
Luisa Palicio
– Photo Juan Ramon Vera –
C’est aussi pour les danseuses, le costume le plus délicat à manipuler. Mont de Marsan s’était offert cette année la maîtresse dans l’art de la bata de cola, accompagnée de l’une de ses plus brillantes élèves. Milagros Menjíbar, à bientôt soixante printemps si elle n’a plus la fougue et la rapidité de sa jeunesse, nous donne une vraie leçon de flamenco, jouant de sa robe, de son chanteur, et de nous spectateurs, mais le duende, ce phénomène qui n’appartient qu’au flamenco avait, ce soir-là, pris possession de Luisa Palicio, l’élève. Belle, racée, nerveuse, jouant de l’éventail et faisant corps avec ses robes qui n’étaient en fait que le prolongement de son propre corps, elle a su nous prendre dans les rets de sa danse provoquant émotion et exaltation, parfaitement suivie par les musiciens, eux aussi subjugués par cette prodigieuse danseuse.
Farruco. Héritier d’une longue dynastie de danseurs admirables, Farruco frère du célébrissime Farruquito, bailaor attitré de Paco de Lucía s’impose comme un danseur puissant, au zapateado impressionnant voire agressif parfois tant il semble se battre avec le tablao. Dans une première partie, où aux instruments traditionnels s’ajoute une batterie, parfois un peu trop présente voire bruyante, le danseur (jeans et veste en satin) nous démontre sa parfaite connaissance de la danse flamenca. La deuxième partie, plus traditionnelle peut-être, avec une guitare qui « sonne » vraiment flamenco et un chanteur inspiré, donne au danseur l’occasion de nous montrer son vrai visage dans l’interprétation d’une solea dont il dit lui-même qu’elle est « la sombra que va detrás de un sueño », l’ombre qui poursuit un songe. Même si ses bras manquent parfois de cette souplesse qui est la marque de cette danse, Farruco mérite amplement les applaudissements qui saluèrent sa prestation.
Farruco – Photo Juan Ramon Vera –
Israël Galván : « La Edad de Oro »
On ne présente plus ce surdoué de la danse, qui à l’instar d’un Antonio Gadés dans les années soixante, a révolutionné la danse flamenca en lui donnant une dimension très contemporaine. Rompant avec les canons traditionnels, le danseur introduit une nouvelle gestuelle plus hiératique, qui donne parfois l’impression d’une image stroboscopique tant les attitudes paraissent saccadées.
Israël Galván
– Photo Sébastien Zambon –
Et puis tout à coup arrivent les gestes d’une incroyable souplesse, des mains « comme des colombes » qui tracent de précieuses arabesques, toute la félinité qui va de pair avec la danse flamenca masculine. Israël Galván est un chercheur qui a parfaitement assimilé la tradition, qui en connaît toutes les règles, tous les « palos », toutes les cadences, tous les ports de bras. Sa recherche est une recherche sur lui-même. Ne dit-il pas que la scène est son laboratoire. Sobrement entouré d’un guitariste et d’un chanteur, Alfredo et David Lagos, impressionnants chacun par la pureté et la beauté de leur interprétation, Israël Galván danse pour lui seul, avec fougue, habité qu’il est par cette force née des racines du flamenco. La standing ovation qui le réveilla de son rêve était à la mesure de son interprétation.
Et Rocío Molina : « Danzaora »
Nouvelle icône du flamenco, cette jeune danseuse, initiée à la danse par Antonio Canales et élève de María Pagés, pourrait être le complément féminin d’Israël Galván, « le yin et le yang » comme l’a écrit un critique à propos du duo mythique que formaient Matilde Coral et Chano Lobato. Comme le danseur, elle parle aussi de laboratoire, de travail sur elle-même. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Elle maîtrise à la perfection tous les codes de l’art flamenco. Avec sa plastique irréprochable, mise en valeur par des costumes fort loin, eux, de la tradition, elle s’enroule telle une liane autour de la musique et du chant. Mais elle va bien au-delà de ce que l’on connaît du flamenco. Elle puise aux racines profondes, retrouvant des accents orientaux qu’elle accompagne elle-même au riqq, cet instrument cousin du tambourin. Elle explore tous les horizons, tous les espaces avec une énergie et une sensualité mais aussi une mélancolie qui subjugue un public muet d’émotion, mais qui retrouva voix et mains pour saluer la fin de la prestation de cette perle de la danse flamenca à l’éclat incomparable.
Rocío Molina – Photo Juan Ramon Vera –
Mais ce Festival ne se résume pas à la danse, même si elle y a une part si belle que c’est certainement beaucoup de ces images que le public gardera en mémoire le plus longtemps.
Le flamenco c’est aussi, et d’abord peut-être, la musique et le chant. Bien sûr la tradition est ici largement représentée par la voix puissante de José Valencia et celle de sa cousine Anabel. Et, tout comme la danse, la musique flamenca évolue, preuve qu’il s’agit bien d’un art vivant. David Dorantes a choisi le piano pour exprimer sa nature gitane. Alors bien sûr on reconnaît les palos traditionnels, mais, et bien qu’il s’en défende, tout cela a un petit air jazzy, soutenu par une magnifique contrebasse jouée avec une délectation, une fougue extraordinaire par le cubain Yelsi Heredia. Comment dans ces conditions ne pas croire à l’universalité de la musique ?
Esperanza Fernández – Photo Juan Ramon Vera –
La gitane de Triana, Esperanza Fernández, participait au spectacle, accompagné par le pianiste. Cette chanteuse possède une voix d’une pureté extraordinaire, et exprime avec une force incroyable les sentiments de ce peuple si longtemps persécuté (mais peut-on vraiment en parler au passé ?). « Gelem, gelem » cet hymne écrit en mémoire des gitans déportés dans les camps de concentration, ce que l’histoire oublie bien souvent de rapporter, fit couler les larmes de la chanteuse, mais également d’un bonne partie du public, frissonnant d’émotion au rythme lancinant de cette plainte. Si l’on précise qu’à cette soirée la danse fut représentée par Rocío Molina, on peut aisément affirmer qu’elle fut l’une des plus chargées en émotion du festival.
Ce furent cinq jours magnifiques, et il nous faut saluer ici le talent, le savoir-faire et la très grande disponibilité des organisateurs, qui, festival après festival, hissent Mont de Marsan sur les plus hautes marches del « Arte flamenco ».