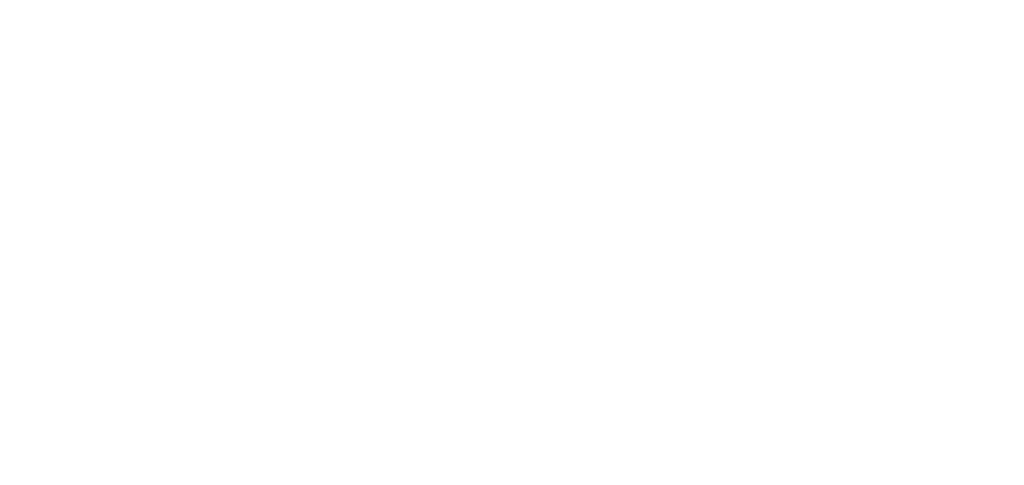Tout comme à Vérone, l’Aïda de Verdi est certainement l’œuvre la plus affichée des Chorégies d’Orange. Ne nous leurrons pas, les célèbres trompettes de la marche triomphale du 2ème acte ont fait plus pour la célébrité de cet ouvrage que l’air du Nil qui en est pourtant l’acmé musicale. Tout le mystère de cet ouvrage est là.
Connu, reconnu, adulé pour une seule et unique scène à grand spectacle (le triomphe), cet opéra est en fait une œuvre profondément intimiste dans laquelle s’enchaînent solos, duos et trios exhalant l’éternelle complainte des amants malheureux. C’est un opéra qui, il faut le souligner, se trouve entièrement dans le dernier mode verdien. Le Trouvère, Rigoletto et Traviata sont loin, le compositeur a déjà signé Simon Boccanegra, Un Bal masqué, La Force du Destin et Don Carlos. Autrement dit, il s’est foncièrement éloigné d’un bel canto post donizettien et vient de jeter les bases du drame lyrique, celui qui aboutira à Otello. Aïda appartient donc à cette dernière manière dont la caractéristique essentielle est celle d’un flux musical continu, d’une subtilité de ton et d’harmonie comme jamais auparavant Verdi ne nous a offert. L’Orchestre du Capitole, sous la direction de Tugan Sokhiev, met ses pupitres virtuoses au service d’une partition éblouissante de couleurs, toute imprégnée d’un formidable lyrisme et au service d’une vocalité étourdissante. Les chœurs des opéras de région (Tours, Nice, Avignon et Angers) assument l’une des parties chorales les plus lourdes de toute l’œuvre verdienne.
Scène du Temple – Crédit photo : Philippe Gromelle Orange
En habitué des lieux, le metteur en scène Charles Roubaud a la charge de monter cet opéra… pour la seconde fois in loco. Il décide de propulser l’action à la fin du 19ème siècle, le Roi devenant de facto le Khedive Ismaïl Pacha. Lors des scènes d’ensemble, il est entouré d’Européens dont il est aisé de deviner leur contrôle, ou du moins leur surveillance attentive, sur les décisions du monarque.
Une distribution homogène
Distribuer Aïda n’est pas une mince affaire. Raymond Duffaut connaît les difficultés de cet ouvrage mieux que quiconque. Il a donc renouvelé sa confiance à Indra Thomas, celle-là même qui avait interprété ce rôle à Orange en 2006. Ce soprano aux moyens impressionnants possède une superbe ligne de chant et la puissance de projection indispensable au Triomphe du deuxième acte. L’émission est ronde et la couleur sombre de son timbre se conjugue à merveille aux tourments qui agitent la jeune éthiopienne. Si le meurtrier Ut du Nil ne l’a malheureusement pas épargnée (trac, tempo trop lent ?), il n’enlève rien à l’interprétation globale d’une des rares interprètes de ce rôle dans le monde aujourd’hui. La princesse égyptienne est un mezzo-soprano dont le répertoire alterne Verdi et Wagner avec constance. Il s’agit d’Ekaterina Gubanova. Son Amnéris possède la vaillance nécessaire à cet emploi. Son aigu d’airain, bien accroché, passe avec brio tous les obstacles du terrifiant premier tableau du 4ème acte.
Duo Aïda (Indra Thomas) et Amnéris (Ekaterina Gubanova)
Crédit photo : Philippe Gromelle Orange
Le ténor Carlo Ventre a fait de Radamès l’un de ses rôles de prédilection, l’interprétant aux quatre coins de la planète. Devant le Mur et face à un orchestre à certains moments particulièrement sonore (scène du Temple, Triomphe), sa projection est prise en défaut, d’autres moments nous permettant d’apprécier tout de même un timbre homogène et une belle ligne de chant. L’Amonasro d’Andrezj Dobber est, au vu des qualités connues de ce baryton, assez décevant. Cependant son manque d’autorité dans le Triomphe n’entache en rien le superbe legato dont il fait preuve dans l’acte du Nil. Un modèle ! A réentendre bien sûr dans des Verdi plus bel cantistes (Rigoletto, Don Carlos, etc.). C’est un bonheur sans mélange que de retrouver Giacomo Prestia, magnifique Ramfis, au timbre somptueux et à la ligne de chant exemplaire. S’il vaut mieux oublier le Roi totalement hors de propos de Mikhail Kolelishvili, il convient de souligner la courte mais évocatrice intervention de Julien Dran (le Messager), un jeune ténor bordelais de 28 ans qui fait entendre ici des qualités de phrasé et de timbre ainsi que d’homogénéité et de projection prometteuses.