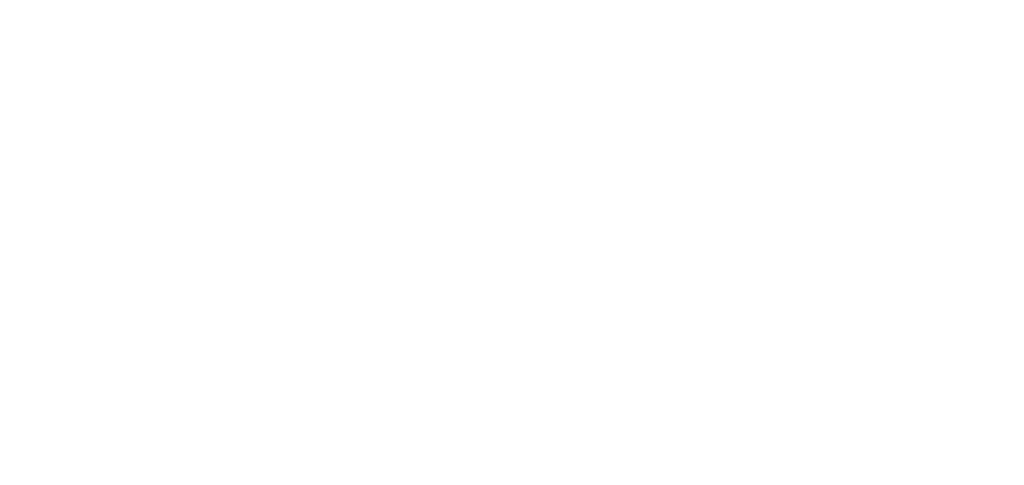Dire que cet enregistrement, réalisé entre 2011 et 2013, était attendu est un doux euphémisme. Le voici en tête de gondole classique, poussé par la puissance de feu d’Universal. La cantatrice transalpine s’attaque ici à l’un des plus grands rôles féminins de l’opéra, un rôle dont l’interprétation a été marquée, et de quelle manière, par Callas, Gencer, Sutherland et Caballé. Pour ne parler que des ces quatre légendes de l’art lyrique.
Le résultat est, en fait, assez consternant. De nombreuses raisons à cela et le moins, après une telle assertion, est d’en passer en revue quelques-unes. La moindre n’est pas l’autojustification, signée de cette médiatique diva, contenue dans la plaquette de ce coffret. Cette cantatrice, dont on connaît autant la virtuosité vocale que la limite des moyens, avance une révision de la partition qui, d’une part, n’est pas une vraie nouveauté et d’autre part, vise surtout à justifier ses choix, particulièrement vocaux. Et voici notre sympathique artiste en train de réveiller les voix de La Pasta et de Grisi. Ces noms qui fleurent bon la légende dorée de l’opéra n’ont cependant pas laissé dans la mémoire des contemporains de souvenirs toujours impérissables. La Pasta, qui créa le rôle-titre de Norma, eut une carrière relativement courte d’une vingtaine d’années. Sa voix était instable, elle navigua en permanence entre la tessiture de mezzo et celle de soprano. Il y a fort à parier que c’était une vraie falcon avec des registres pas du tout soudés et une tendance certaine à chanter bas. Giulia Grisi, qui fut la première Adalgisa, chanta Norma également, créa l’Elvira d’I Puritani ainsi que, et rien n’est moins anodin, le Roméo d’I Capuleti e i Montecchi, rôle qui fut écrit par Bellini à son attention et qui requiert une vraie tessiture de mezzo, ou, encore une fois, de falcon. Quant au ténor Donzelli, le premier Pollione, il est considéré, de par son timbre sombre, son large phrasé et sa puissance dramatique, comme le maillon entre les baryténors et les ténors dramatiques romantiques. En tout état de cause, il fut le modèle du fameux Duprez, celui-là même qui chanta pour la première fois sur scène un ut de poitrine.
Que nous propose Cecilia Bartoli ici pour un enregistrement dans lequel ne doutons pas un instant que ses options ont été prépondérantes ? Avant tout, et c’est assez stupéfiant, la naissance d’un nouveau style : le vérisme bellinien, des « rrrr » qui n’en finissent pas de rouler, des « ssss » qui n’en finissent pas de siffler, une absence quasi totale du moindre cantabile (!), malgré des micros plus que complaisants une projection qui sature vite et se retrouve réfugiée en gorge,
une espèce de phrasé qui flirte parfois avec l’hystérie, quelques séquences de vocalises stroboscopiques dont elle a le secret, de maigres ornementations et, plus grave, un trou dans la voix (médium) qui ne demande certainement qu’à s’agrandir si cette artiste persiste dans sa vocation à révolutionner, à sa manière, tout l’art lyrique du 19ème siècle, Puccini inclus !
Sans parler du personnage, ici réduit par des tempi sans ampleur à une femme banale trompée par son mari. Où sont donc les visions sublimes de cette druidesse prédisant la chute de Rome ? Il n’est que de voir le visuel de ce coffret dans lequel elle semble jouer avec l’image de la Magnani pour comprendre le néoréalisme dans lequel la cantatrice s’est fourvoyée pour mieux dissimuler l’inadéquation totale de sa voix à la grandeur de ce personnage. Le trucage va plus loin avec Adalgisa. Nous avons vu plus haut que la Grisi avait créé Roméo. Voici ce rôle tenu ici par un soprano léger : Sumi Jo. Regardons un instant simplement le fameux duo « Mira o Norma ». Ce n’est pas difficile de voir que la partie de Norma est toujours au-dessus de celle d’Adalgisa. Bien sûr Adalgisa est plus jeune que Norma dans le drame, mais la partition de Bellini est là. Point barre. Cela dit, ce subterfuge permet ainsi à Bartoli de dominer le duo, du moins en studio. La cantatrice sud-coréenne peine bien sûr dans toutes les nombreuses parties medium et grave du rôle. Problème également avec John Osborn qui chante le Proconsul romain. Que Cecilia Bartoli se permette de dézinguer nommément Mario del Monaco et Franco Corelli dans ce rôle, c’est son affaire. Le ténor américain, dont on devine dès la première phrase les problèmes d’appui dans le grave, s’aventure dans des ornementations dont il n’a pas les moyens. Le phrasé et l’élégance sont là, mais on ne croit pas une minute au personnage. Seul Michele Pertusi sort son épingle du jeu dans un rôle (Oroveso) à l’écart de tout danger. Au bout d’un moment tout cela devient bien artificiel et se transforme en pur produit marketing dont on ne pourrait retenir, à la rigueur, qu’une nouvelle lecture orchestrale avec l’Orchestra La Scintilla, dont les sonorités paraissent bien vertes et agressives et les tempi bien hachés cependant, sous la direction de Giovanni Antonini. Quant à retrouver les phrasés, les couleurs, les nuances, la suavité d’un Bellini…
Avant de terminer, soulignons tout de même l’enthousiasme de Cecilia Bartoli dans la fabrication de ses produits ressuscitant Caldara, Steffani, Salieri, etc. C’est la même chose ici, à tel point que, dans le feu de l’action, elle attribue, page 28, La Sonnambula et Norma à… Donizetti !
En conclusion, je ne résiste pas à reprendre un extrait du texte signé par cette nouvelle Norma : « …Maria Callas était parfaitement au fait du legs laissé par la Pasta et la Malibran. Callas ne put cependant s’affranchir ni du goût de son époque, marqué par le vérisme, ni des règles dramaturgiques alors en vigueur ». Il n’y a qu’à lire deux pages de n’importe laquelle des nombreuses biographies de cette immense cantatrice pour apprécier à sa juste dimension l’impertinence, la fatuité et le manque d’objectivité de pareils propos.