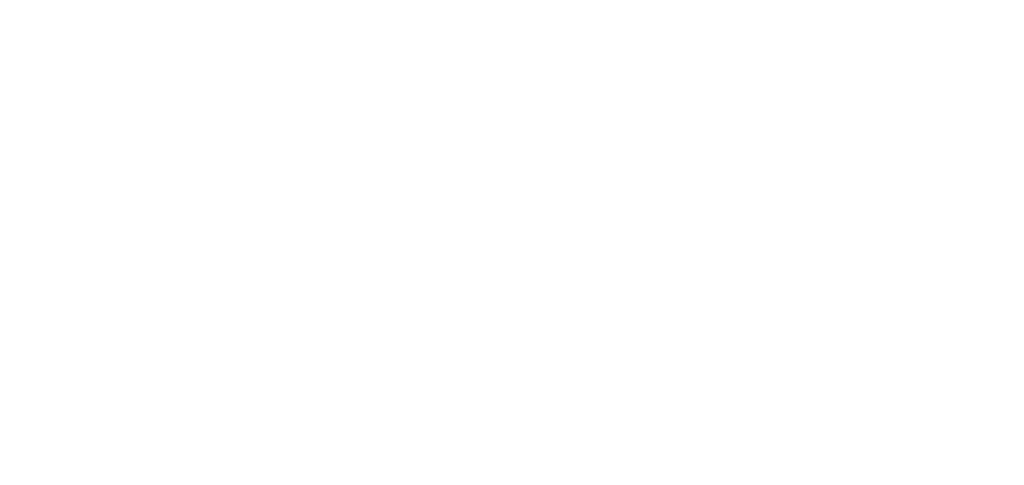En ce printemps pluvieux les balletomanes étaient invités à monter à bord d’une goélette en route vers le lointain Orient avec à la barre un capitaine nommé Kader Bélarbi. L’histoire qu’il souhaitait nous raconter avait plus d’un siècle et demi, et l’un de ses prédécesseurs, Joseph Mazillier, l’avait déjà mise en pas au milieu du XIXème siècle. Et, passé autant d’années, les histoires vieillissent parfois. C’est pourquoi le chorégraphe toulousain a choisi de réécrire le scénario de ce « Corsaire » qui vit le jour en 1856, afin de rendre le récit plus limpide, plus facile d’accès, en un mot plus cohérent dans son déroulement.
María Gutiérrez et Davit Galstyan © DR Théâtre du Capitole
Pour ce faire, au-delà de la réécriture du livret, il a également souhaité retravailler l’écriture musicale, en revisitant la partition d’Adolphe Adam et en y introduisant des musiques de Massenet, d’Arenski, de Lalo ou encore de Sibelius. C’est au chef David Coleman, un habitué de la scène toulousaine, qu’ont été confiés le remaniement et la réorchestration de cette nouvelle partition, ainsi que la composition des liaisons rendues nécessaires pour cette mosaïque musicale. Le résultat en est plaisant mais, nous semble-t-il, demande encore à être travaillé. Cependant, il est toujours très agréable pour les spectateurs que nous sommes de voir de la danse accompagnée par un orchestre, chose qui devient rare à Toulouse.
La production, d’une extrême élégance, a été conçue par Kader Bélarbi dans toujours ce même souci de clarté. Ici point de tutus et pourpoints de princes romantiques comme dans les productions anciennes, les us orientaux s’en accommodent peu. Les costumes d’Olivier Bériot sont somptueux : pantalons bouffants en voile léger et boléros brodés de sequins pour les danseuses ; pour le sultan et les marchands, des pantalons de soie sous des caftans damassés. Seuls les vêtements du peuple et de l’équipage du navire corsaire, comme il se doit, ne brillent pas de mille feux. Le décor, imaginé par Sylvie Olivé est un écrin sobre en contrepoint de cette palette brillante et colorée. Des armatures légères recouvertes de diaphanes voiles blancs évoquent l’arc outrepassé des architectures maures, ou les colonnes de quelques temples grecs (qui nous ramènent à l’origine du récit) ; un pouf immaculé ouvre en corolle ses fines nervures soyeuses pour servir de sofa, tandis qu’un précieux paravent de papier plissé se déploie comme un éventail en fond de scène. Trois plaques mobiles descendent des cintres et nous voici sur le navire, qui, à la fin du ballet, évoque ce radeau en plein naufrage que peignit Géricault.
María Gutiérrez et Takafumi Watanabe © DR Théâtre du Capitole
Le décor est en place. Et quant à la danse ? Kader Bélarbi voulait faire « un grand ballet académique, épique, aux parfums orientalistes sans tomber dans les clichés ». Et ainsi en est-il : son écriture est effectivement très académique. La grammaire et le vocabulaire des grandes œuvres classiques y sont parfaitement mis en œuvre. Si les danseuses ne portent pas de tutus, elles sont en revanche pratiquement toujours sur pointes. Tous les ingrédients du ballet romantique sont présents : petite et grande batterie, arabesque, tour, jetés pour les filles, manège, grand jeté, portés souvent vertigineux, toujours athlétiques pour les garçons. Le découpage entre solos, pas de deux et ensembles est harmonieusement mené. Les ensembles mettent en scène presque tout le corps de ballet, et comme toujours, sont parfaitement en place. Il peut y avoir ici ou là quelques réminiscences : un harem et un déroulé de danseuses que ne renierait pas une Bayadère, ou bien l’entrée et la ronde des Péris, cousines orientales des Willis du nord. A l’origine, les rôles principaux devaient être interprétés par les solistes de la troupe. Hélas, la pratique de la danse est difficile et peut parfois être cruelle. Ainsi Tatyana Ten d’abord, puis Kasbeck Akhmedyarov se blessèrent peu de jours avant la première. Ces accidents, outre les très mauvais moments que vivent les danseurs, sont un cauchemar assuré pour le directeur de la danse qui doit remédier au plus vite à cette situation. Mais la muse Terpsichore veillait, et deux brillants danseurs répondirent à l’appel du chorégraphe : Kateryna Shalkina, soliste du Béjart Ballet Lausanne, et Yoël Carreño, soliste au Ballet national de Cuba avant d’intégrer le Ballet National de Norvège à l’automne 2010. Ils acceptèrent la gageure d’apprendre des rôles aussi longs et lourds en un temps record. Et nous nous devons de saluer ici une performance que seuls les grands peuvent accomplir : Kateryna eut douze jours pour le faire, et Yoël, seulement six. La Belle Esclave était donc interprétée en alternance par María Gutiérrez et Kateryna Shalkina, tandis que le Corsaire prenait les traits de Davit Galstyan et Yoël Carreño.
Katherina Shalkyna et Pascale Saurel © DR Théâtre du Capitole
Les deux danseuses possèdent, l’une et l’autre, une technique remarquable qui leur permet de se jouer des difficultés chorégraphiques que Kader Bélarbi n’a pas manqué de glisser dans le ballet. Belle et rayonnante, Kateryna Shalkina campe une esclave qui se rebelle contre son sort avec beaucoup de force et de musicalité à la fois. Ses équilibres et ses tours nous offrent une parfaite illustration de l’élégance classique. María Gutiérrez aborde le rôle dans un autre registre. Elle y est bouleversante de fragilité et de tendresse. Artiste accomplie, elle joue à la perfection cette jeune femme apeurée, blessée dans son cœur et dans son corps, mais éperdue d’amour, telle que l’a voulu le chorégraphe. Sa musicalité, son lyrisme, son charisme sur scène emportent l’adhésion du public. Auprès d’elle Davit Galstyan est le Corsaire. Précis, athlétique, bondissant, il interprète avec un sens aigu du théâtre ce rôle, qui au-delà de cela, demande des qualités techniques qu’il possède de manière évidente. Enfin, le couple qu’il forme sur scène avec María a su trouver, cette saison, une complicité, une connivence, une intelligence des rôles qui ne peut que nous ravir.
María Gutiérrez © DR Théâtre du Capitole
Dans la seconde distribution Le Corsaire était donc Yoël Carreño. Que dire si ce n’est la perfection technique de ce danseur ? L’école cubaine éclate avec lui dans toute sa splendeur : ses sauts, ses manèges, ses tours, ses portés, tout fait que le public retient son souffle avant d’applaudir. La scène capitoline semble trop étroite pour ce danseur qui allie à une virtuosité exemplaire une musicalité d’aussi grande qualité. Au-delà d’une technique ébouriffante, il sait également être un partenaire attentif, modeste et un véritable homme de théâtre. L’ovation qui fit suite à ses variations au dernier acte suffirait à elle seule à exprimer l’émotion qu’il sut nous donner lors des deux soirées où il dansa. Et on se prend à rêver d’un corsaire réunissant María et Yoël…
Yoël Carreño © DR Théâtre du Capitole
A leurs côtés nous retrouvions, en alternance dans le rôle du sultan, Valerio Mangianti et Takafumi Watanabe. Le premier campe un sultan tout puissant, cruel, menaçant et violent, tandis que le second nous donne à voir un personnage inquiétant dans sa cruauté plus froide mais non moins redoutable. Tous les deux assurent, avec le talent qu’on leur connaît, le rôle du méchant de l’histoire, avec l’élégance que leur confèrent leurs silhouettes élancées. La Favorite, au somptueux costume, a pris le visage de Juliette Theulin et Pascale Saurel, toutes deux jouant à merveille le rôle retors qui leur échoit. Enfin soulignons l’interprétation du Compère qu’ont donnée avec brio Demian Vargas (mais ce n’est plus une surprise dorénavant) et Shizen Kazama, depuis peu dans la Compagnie et qui, après sa variation dans Napoli, nous donne encore une raison supplémentaire de le suivre de près.
Si la chorégraphie de ce ballet n’est pas bouleversante en soi tant elle nous semble familière, elle a le mérite de rendre beaucoup plus lisible une œuvre un peu embrouillée et disparate, fort peu remontée depuis l’origine (du moins dans sa version française originale), et dont seul le pas de deux du dernier acte échappe un peu à l’oubli dans la mesure où il fait partie du répertoire des plus grands comme, pour ne citer qu’eux, Rudolf Noureev et Dame Margot Fonteyn, par exemple.