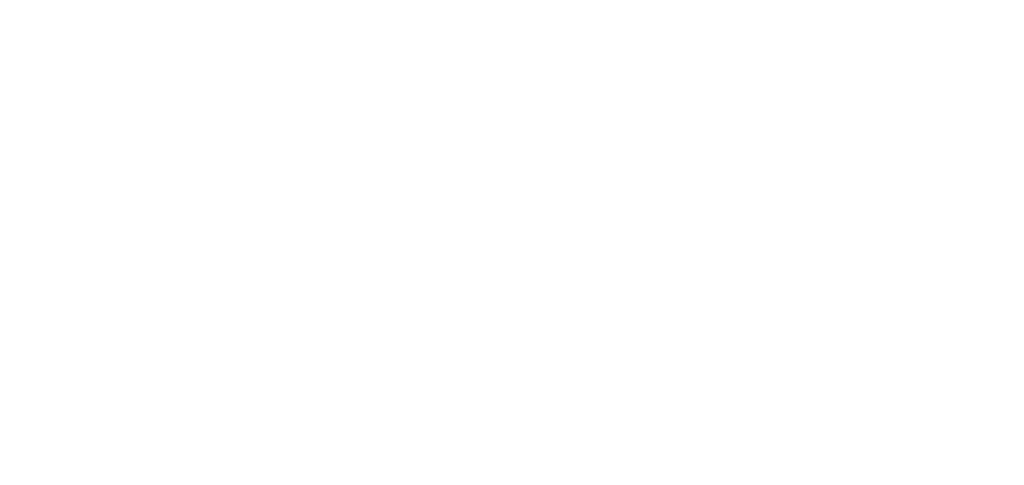Le chef d’orchestre danois Thomas Dausgaard doit être chaleureusement remercié. Remplaçant Myung-Whun Chung souffrant, il conduit les musiciens du Philharmonique de Radio France à se dépasser dans un programme musical exigeant. Invitée à participer à la saison des Grands Interprètes, la phalange parisienne était à la Halle aux Grains de Toulouse le 26 novembre dernier.
Mendelssohn et Bruckner, tous deux inscrits au programme de ce concert, le rapprochement n’est pas si fortuit qu’il y paraît. L’un et l’autre se trouvent à la charnière entre deux mondes. Mendelssohn, le classique, ouvre la voie au romantisme, alors que Bruckner souffle sur les dernières braises de ce même romantisme, avant le grand chambardement de l’atonalisme.
La symphonie Italienne, qui ouvre la soirée, est abordée ici comme une œuvre de musique de chambre. L’effectif choisi reste modéré. L’élan rythmique, toujours présent, la finesse des phrasés, la légèreté du trait font ici planer l’ombre de Haydn. Le chef construit l’édifice avec lucidité et détermination, caractérisant chaque mouvement de manière bien spécifique. La large palette des nuances se manifeste dès l’ouverture de l’Allegro vivace initial. La marche mystérieuse de l’Andante con moto, qui ne manquera pas d’inspirer celle que Berlioz introduit dans son Harold en Italie, conduit en douceur au Con moto moderato, tendre comme une confidence. La dynamique raffinée suscitée par le chef fait ici des merveilles. Enfin, le Saltarello final, vif, joyeusement effervescent, conclut cette première partie sur un sourire éclatant.
Le Philharmonique de Radio-France, dirigé par le chef danois Thomas Dausgaard,
à l’issue de son concert toulousain – Photo Classictoulouse –
Des neuf symphonies d’Anton Bruckner, la quatrième est certainement, avec la septième, la plus populaire. Baptisée « Romantique » par son auteur lui-même, elle est construite sur un schéma classique en quatre mouvements obéissant, en principe, à un programme pseudo-médiéval qu’il n’est pas vraiment nécessaire de connaître. Maintes fois remaniée, comme la plupart des symphonies du « Ménestrel de Dieu », elle s’impose d’elle-même par l’ouverture sur des horizons sonores et expressifs qui marient ferveur mystique et panthéisme passionné. La conduite de ces crescendos implacables qui débouchent sur le silence, comme autant d’élans inaboutis, constitue la signature reconnaissable entre toutes de l’écriture brucknérienne. Thomas Dausgaard, à la tête d’un orchestre somptueusement sonnant, montre ici des qualités impressionnantes de bâtisseur. Sa vision très personnelle, subtilement analytique, de la partition est basée sur une véritable dramaturgie. Construite avec un soin extrême, « sa » quatrième met en évidence tous les détails d’une orchestration qu’il rend aussi transparente que possible. Les brumes des grandes versions du passé, de Furtwängler à Celibidache en passant par Jochum sont ici éclairées d’une lumière franche. Chaque détail reste audible, aussi bien dans les extrêmes pianissimi que dans l’extase des fulgurances telluriques. L’Allegro molto moderato s’ouvre sur un redoutable solo à faire frémir plus d’un cor solo. Le soliste du Philharmonique chargé de cette tâche stratégique est à saluer bien bas. Quelle finesse, quelle assurance, quelle perfection instrumentale ! L’ovation finale que lui réserve le public est à la hauteur de la performance. Après les complexes développements de ce premier volet dont le chef éclaire l’agogique tourmentée, l’Andante quasi allegretto retrouve des accents de musique de chambre. On retient sa respiration lors de ces silences profonds comme des abîmes. Atmosphère raréfiée, émotion contenue. Dans le célèbre Scherzo, plus médiéval que nature, les pupitres de cuivres s’en donnent à cœur joie. Des nerfs et du muscle, sans une once d’embonpoint caractérisent ici la direction de Thomas Dausgaard qui suggère avec poésie les liens qui rapprochent le trio de ceux du tendre Schubert. C’est enfin l’ultime « Bewegt, doch nicht zu schnell » (Animé, mais pas trop rapide), qui peu à peu, marche après marche, conduit au paradis après un crescendo final, enfin assouvi, qui laisse sans voix. L’orchestre répond avec ferveur à chaque indication du chef dont la gestique très personnelle évoque par moment une chorégraphie d’une redoutable efficacité. Du grand art !